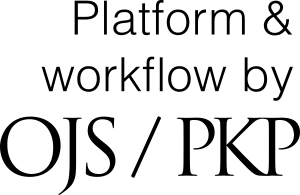À qui profite la « transition » des territoires touristiques pyrénéens ? Le cas de la Haute-Ariège
Mots-clés :
Pyrénées, Vallées d’Ax, Tourisme, Transition, Espace conçu VS Espace vécu, géographie radicaleRésumé
Cet article analyse les recompositions socio-spatiales des territoires touristiques pyrénéens, et en particulier du territoire des Vallées d’Ax en Haute-Ariège, dans un contexte de « transition » d’un modèle économique à bout de souffle, celui des stations de ski. Au prisme de la géographie radicale, en mobilisant notamment les travaux d’Henri Lefebvre et de David Harvey, il interroge l’opportunité que peut représenter ce moment charnière pour une restructuration géographique du capital. À partir des résultats d’une enquête de terrain réalisée auprès d’habitants et habitantes du territoire des Vallées d’Ax et des acteurs et actrices de l’aménagement touristique du massif pyrénéen, cet article met en lumière le décalage entre l’espace « conçu » par les aménageurs et l’espace « vécu » par les habitant·es. D’un côté, le territoire conçu s’apparente à un « territoire-entreprise », largement axé sur le développement du tourisme et des loisirs, qui permet la réalisation de rentes de monopole via le « capital symbolique collectif » fort des Pyrénées et le développement de partenariats public-privés. Les habitant·es de ce territoire sont relégué·es à leur statut de travailleur·euses/figurant·es, à la fois force de travail et garant·es de l’« authenticité » et de l’« hospitalité » pyrénéenne. De l’autre côté, l’habitabilité de ces espaces se voit remise en cause, notamment du fait des difficultés d’accès au logement induites par les logiques de développement touristique, qui peuvent aussi être un frein à l’organisation collective des habitant·es. Le territoire vécu est donc subi par ses habitant·es qui tentent d’y négocier leur place et peuvent difficilement se l’approprier, quand ils et elles ne doivent pas purement et simplement le quitter.